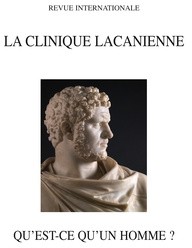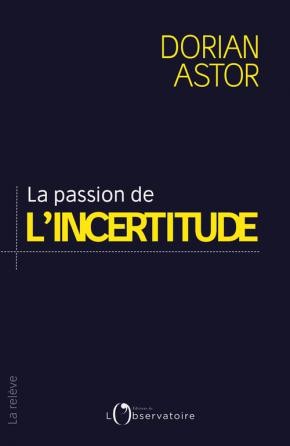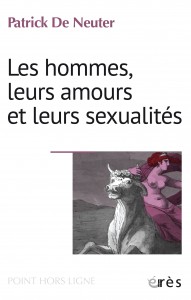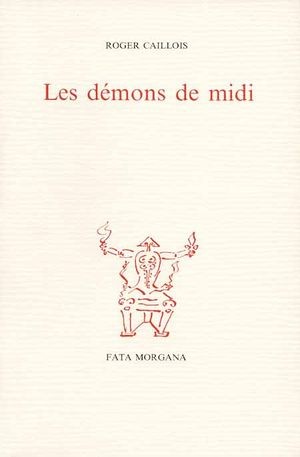Genèse du discours psychanalytique (Quelle histoire !) par le retour à la clinique
Voici la transcription de la séance du 16 avril 2024 du séminaire de Jean-Richard Freymann : elle rassemble et approfondit les élaborations essentielles apportées sur la thématique de l’année.
Nous allons aborder aujourd’hui la question du rapport très délicat entre la question des pulsions et la question du fantasme, ou des fantasmes. C’est une question que j’ai pas mal travaillée et cette année c’est un peu le point sur lequel je veux qu’on aboutisse. Pour vous montrer qu’il y a une espèce de confusion, que Freud interroge d’ailleurs, que Lacan confond aussi par moments, entre ce que seraient les scénarios pulsionnels et le scénario fantasmatique. C’est un point qui est important parce que ça reprend un peu toute la pathologie psychanalytique. Et Lacan s’est arrêté à cet endroit-là, Freud aussi.
Je vais commencer par quelque chose qui va un peu vous étonner : je vais reprendre un texte que vous connaissez peut-être de Raymond Devos qui s’appelle « Qui tuer ? ». Il nous parle là de la question du scénario pulsionnel, en ce sens que c’est ce qui qualifie cette espèce de constance pulsionnelle… pour Freud il y a quelque chose d’une constante dans la dynamique pulsionnelle qu’on a du mal à ressentir. Bien sûr, quand vous êtes pris dans votre génitalité de tous les jours, vous vous demandez comment on peut trouver du pulsionnel qui serait constant… ce serait magnifique ! Mais ce n’est pas exactement comme ça que ça se passe. Alors je vais vous lire ce texte qui est quand même extraordinaire et qui montre la capacité, avec la question justement pulsionnelle, du retournement qui peut s’opérer, qui n’est pas tout à fait la même chose que les questions qui vont être posées sur l’aliénation, la séparation, les histoires de métaphores, de métonymies. Ça a un statut un peu à part. C’est d’ailleurs quelque chose qui se retourne dans la figure assez facilement dans la vie de tous les jours : vous êtes pris dans un certain scénario et brutalement vous vous rendez compte que ce qui est en train de se passer est le contraire de ce que vous attendiez.
Voici le texte de Raymond Devos : « Qui tuer ? »
Un jour,
en pleine nuit…
mon médecin me téléphone :
– Je vous réveille pas ?
Comme je dormais, je lui dis :
– Non.
Il me dit :
– Je viens de recevoir du laboratoire
le résultat de nos deux analyses.
J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
En ce qui me concerne, tout est normal.
Par contre, pour vous… c’est alarmant.
Je lui dis :
– Quoi ? Qu’est-ce que j’ai ?
Il me dit :
– Vous avez un chromosome en plus…
Je lui dis :
– C’est-à-dire ?
Il me dit :
–Que vous avez une case en moins !
Je lui dis :
– Ce qui signifie ?
– Que vous êtes un tueur-né !
Vous avez le virus du tueur.
Je lui dis :
– Le virus du tueur ?
Il me dit :
– Je vous rassure tout de suite.
Ce n’est pas dangereux pour vous,
mais pour ceux qui vous entourent…
ils doivent se sentir visés.
Je lui dis :
– Pourtant, je n’ai jamais tué personne !
Il me dit :
– Ne vous inquiétez pas… cela va venir !
Vous avez une arme ?
Je lui dis :
– Oui ! un fusil à air comprimé.
Il me dit :
– Alors, pas plus de deux airs comprimés par jour !
Et il raccroche !
Toute la nuit… j’ai cru entendre
le chromosome en plus qui tournait en rond
dans ma case en moins.
Le lendemain, je me réveille avec une envie de tuer…
irrésistible !
Il fallait que je tue quelqu’un. Tout de suite !
Mais qui ?
Qui tuer ? qui tuer ?
Attention ! je ne me posais pas la question :
« qui tu es ? »
dans le sens : « qui es-tu, toi qui cherches qui tuer ?
ou : « Dis-moi qui tu es et je te dirai qui tuer. »
Non !… Qui j’étais, je le savais !
J’étais un tueur… et un tueur sans cible !
Enfin…sans cible, pas dans le sens du mot sensible !
Je n’avais personne à ma portée.
Ma femme était sortie…
Je dis :
–Tant pis, je vais tuer le premier venu !
Je prends mon fusil sur l’épaule… et je sors.
Et sur qui je tombe ?
le hasard , tout de même !
Sur le premier venu !
Il avait aussi un fusil sur l’épaule,
(Il avait un chromosome en plus, comme moi !).
Il me dit :
– Salut, toi, le premier venu !
Je lui dis :
– Non, pour moi, le premier venu, c’est vous !
Il me dit :
– Ah non ! Je t’ai vu venir avant toi,
et de plus loin que toi !
Il me dit :
– Tu permets que je te tutoie ?
– Je te tutoie et toi, tu me dis tu !
Je me dis : « Si je dis tu à ce tueur, il va me tuer ! »
Je lui dis :
– Et si on s’épaulait mutuellement ? (…)
Il me dit :
– D’accord !
On se met en joue…
Il me crie :
– Stop ! Nous allions commettre tous deux
une regrettable bavure !
On ne peut considérer deux hommes qui ont le courage
De s’entre-tuer comme des premiers venus !
Il faut en chercher un autre !
J’en suis tombé d’accord !
Là-dessus, j’entends claquer deux coups de feu
et je vois courir un type avec un fusil sur l’épaule…
Je lui crie :
– Alors, vous aussi, vous cherchez à tuer
le premier venu ?
Il me dit :
– Non, le troisième ! J’en ai déjà raté deux !
Et tout à coup, je sens le canon d’une arme
s’enfoncer dans mon dos.
Je me retourne.
C’était mon médecin…
qui me dit :
– Je viens vous empêcher de commettre un meurtre
à ma place…
Je lui dis :
– Comment, à votre place ?
Il me dit :
– Oui, le laboratoire a fait une erreur.
Il a interverti nos deux analyses.
Le chromosome en plus, le virus du tueur,
c’est moi qui l’ai !
Je lui dis :
– Docteur, vous n’allez pas supprimer froidement
un de vos patients ?
Il me dit :
– Si ! La patience a des limites.
J’en ai assez de vous dire :
« Ne vous laissez pas abattre ! »
Je lui dis :
– Vous avez déjà tué quelqu’un, vous ?
Il me dit :
– Sans ordonnance… jamais !
Mais, je vais vous en faire une !
Je trouve que c’est très intéressant parce qu’on retombe aussi sur quelque chose que Freud a travaillé dans les histoires de retournement dialectique concernant Dora. Dora qui est la première psychanalyse de Freud. À cette pauvre Dora qui se plaint de tous les maux, à un moment donné, Freud dit : « Quelle est ta place dans les troubles dont tu te plains. » La première intervention analytique, pourrait-on dire, de Freud dans la question de la psychanalyse, et que Lacan va reprendre plus tard, c’est la question du retournement dialectique. Entre nous, c’est quelque chose qui marche parfois pas mal ; quand vous vous sentez un peu agressé, c’est utilisable.
On est là dans un mécanisme qui n’est pas un mécanisme à proprement parler fantasmatique, qui est justement un mécanisme pulsionnel, qui fait partie de la question pulsionnelle… cette constance retournée où du côté du sens c’est complètement déstabilisé. Ce qu’en dit Lacan, c’est que la pulsion, ce n’est pas le fantasme, c’est un montage du même registre que faisaient les surréalistes, un montage pulsionnel qui est sans finalité.
Vous allez retrouver cette capacité à rendre compte de cette affaire pulsionnelle chez Kafka. Et ce n’est pas dans n’importe quel texte de Kafka, c’est dans les textes qu’il a autorisé à publier, puisqu’il a demandé que la plupart des textes soient enlevés, qu’on les supprime (ce qui n’a d’ailleurs pas été fait… pour notre plus grand plaisir).
Je vais me référer à un des textes de Kafka – où on retrouve un peu du Raymond Devos, Un artiste de la faim à la colonie pénitentiaire.
C’est l’histoire d’un anorexique dont la jouissance est de se montrer comme un anorexique dans une cage, et sa jouissance s’est de se donner à voir dans son amaigrissement assez régulier. Et la mort approche à partir du moment où la capacité de se donner à voir comme anorexique ne fonctionne plus. Quand il n’y a plus le regard de l’autre, l’histoire de l’artiste de la faim, cela se termine par la mort. Ce texte ne commence pas l’histoire de l’artiste de la faim, il commence par une histoire de trapéziste qui reste suspendu toute la journée dans son trapèze et dont la jouissance est de se retrouver dans le trapèze toute la journée, il restait jour et nuit sur son trapèze. Pour le descendre, il fallait prendre un filet à bagages. L’impresario de ce spectacle hésite : « si je vous proposais deux trapèzes au lieu d’un, vous seriez d’accord ? parce que deux trapèzes vaudraient mieux qu’un ». Alors le trapéziste, pris dans son être uni-trapézienne, fond en larmes. L’impresario regarde le trapéziste et en effet il se rend compte que le trapéziste est en train de pleurer. Et qu’est-ce qui apparaît sur le visage du trapéziste ? les premières rides sur le front ! Elles apparaissent dès lors qu’il arrête le trapèze…les mêmes rides qu’on trouve sur le front d’un enfant. Au moment où le mouvement pulsionnel s’arrête, il va retourner en position infantile.
C’est impressionnant, mais ça nous montre le tout ou rien du côté pulsionnel, qu’on ne peut pas arrêter. Vous vous rappelez le « Qui tuer » de Devos, à aucun moment on ne va dire qu’on va arrêter de tuer. La constance freudienne est présente, il y en a un qui va se faire tuer dans l’affaire.
Il y a un autre exemple concernant le côté pulsionnel : dans la « colonie pénitentiaire », vous avez en même temps non seulement la question pulsionnelle, mais vous avez aussi la question du délire, et en arrière-fond se situe l’hommage au commandant. Le commandant est mort mais on a gardé la machine qu’il avait mis en place. Pour que cette scène de la colonie pénitentiaire fonctionne, il faut qu’il y ait naturellement la place du commandant (ce n’est plus le commandant puisqu’il est mort, donc il a un remplaçant), l’observateur qui est invité à regarder, il y a celui qui est train de se faire torturer. On le montre aux visiteurs mais le problème de sa torture et de sa douleur n’est absolument pas en question. Alors cette machine, c’est une espèce de lit, vous avez une herse avec des pointes, et le prisonnier est attaché à l’envers ; on va écrire sur son corps ce qu’on lui reproche, les raisons de sa faute, en se servant de la herse. Ce qui va se passer dans la colonie pénitentiaire, c’est que celui qui s’occupe de la machine est d’une obsessionnalité magnifique, il vérifie que tout soit parfait. Ensuite on le montre aux visiteurs, là on est dans la question pulsionnelle. La machine se met en route et soudain la machine se détraque… catastrophe ! C’est une catastrophe parce que grâce à cette machine il devait y avoir une rédemption promise, et pourtant cela avait pas mal marché puisque la pointe de l’aiguille avait quand même au passage transpercé le front du prisonnier. Le commandant de la machine était mort, on l’a enterré, et voilà que la machine se détraque complètement.
C’est quelque chose d’intéressant du côté du délire, c’est justement ce qui se passe dans un délire, le délire a toujours sa composante de compulsion de répétition, il est aussi toujours pris dans l’essai de répétition, il y a une obsessionnalité délirante importante. De plus dans cette histoire se joue l’aspect religieux, puisqu’il s’agit d’une rédemption, il s’agit de punir. Quelque chose qui nous intéresse pour la pulsion et nos histoires de zones érogènes, c’est qu’on va inscrire la faute sur le corps. Le but c’est d’inscrire les fautes sur le corps. Mais alors, pourquoi ça va se détraquer ? Justement parce que la place du commandant n’est plus là. Comme on pourrait dire, Le Nom du Père qui tenait la machine ne tient plus. Donc tout se détraque. Mais vous voyez, il y a toujours la présence d’un commandant. Mais le problème c’est que le commandant est mort. Il n’y a plus que celui qui fait visiter la place du commandant.
Il y a un autre exemple, quand vous prenez l’histoire du Sein de Philippe Roth. J’avais pris comme exemple de zone érogène, le sein… cette histoire de se prendre pour un sein. Mais là aussi il y a quelque chose qui se passe dans ces zones érogènes… Être le sein c’est une chose mais il y a une dynamique dans la question du sein, il n’est pas simplement le sein. Philippe Roth dit dans son livre : « si je suis un sein, où est mon lait ? » Le scénario de tout ce qui tourne autour des pulsions va tourner essentiellement, contrairement à la question du fantasme, autour de la question des objets, même si ce sont des objets petit a. Je ne parle pas d’objets en général, ce sont des objets petit a qui vont se mettre ensemble et qui vont circuler, comme chez les surréalistes.
Si on lit le livre de Philippe Roth, Le Sein : « Si je suis un sein, où est mon lait ? quand Claire me suce où est le lait ? Si je ne suis qu’un sein, il me faut le lait ». Donc il y a quelque chose qui se joue sur la vérité de l’existence de l’objet, c’est-à-dire l’objet à la limite lui-même, le sein… donc je suis un sein, il faut un autre objet qui serait le lait. Ça touche à quelque chose que Lacan arrive à pointer et qui a à voir avec la question de la zone érogène. Cette zone érogène, elle se situe toujours dans les interstices (au niveau de la bouche, au niveau de l’œil, au niveau de l’anus… il y a quelque chose du bord. Et toute cette histoire du bord, c’est la question topologique. Lacan ne répond pas à la question : comment se fait-il que les zones érogènes ne se situent pas n’importe où ? On tombe sur le dessin qui met d’un côté un point où il y a l’objet et de l’autre il dessine la zone érogène.
Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire d’objet a ? Il ne faut pas tout confondre : cet objet a n’est pas l’objet a du désir. Ces objets a qu’on met en scène dans la question pulsionnelle, ce n’est pas la zone du désir. Alors quel est le schéma de départ qui permet de s’en sortir ? Ce qui permet de se sortir de cette histoire de l’objet a, on le trouve dans le séminaire D’un autre à l’autre. Lacan dit que pour que vous puissiez passer (alors lui à l’époque pose la question du signifiant, qu’est-ce que c’est un signifiant, quels sont les mécanismes du signifiant, etc.) d’un signifiant à l’autre à chaque fois il y a quelque chose de l’ordre d’une perte de l’objet, le signifiant n’a pas tendance à bouger ; vous allez passer d’un signifiant à l’autre parce qu’il va y avoir une perte d’objet, c’est cette perte d’objet qui peut permettre ce glissement. Quel est le statut de cet objet-là ? On passe de la question de la jouissance (je vous rappelle que jouir c’est le propre des pulsions) au « plus-de-jouir », c’est une zone intermédiaire, un espace mobile, et à partir de cet espace mobile ça va produire l’objet a. Lacan, dans tous ses séminaires, va revenir sur le « plus de jouir », dans Les Quatre Discours par exemple. Qu’est-ce qui se passe entre l’objet a des pulsions et l’objet a du désir ?
La vraie formule lacanienne c’est : « Il n’y a pas d’objet dont le désir se satisfasse, il n’y a qu’un objet qui cause le désir. » Le désir n’a pas d’objet, sinon ce n’est pas du désir. Le seul élément de support, c’est le fantasme. Et il y a encore de l’objet a car vous vous souvenez que l’histoire, ô combien lacanienne du fantasme, c’est autre chose. Là on n’a pas seulement de l’objet, on a le sujet S barré losange de A, S <> a. Ce sur quoi va s’appuyer la question du désir inconscient, ce n’est pas la même chose que ce qui va s’appuyer sur le fantasme. Or, le fantasme met en scène la question de l’objet, c’est l’objet du fantasme. Pour Freud, les objets du fantasme, sont : pénis, seins, fèces et ? On a parlé jusqu’à présent de déchaînement des pulsions, là on est en train de glisser. Ça va poser une question, c’est ce démarquage entre le monde pulsionnel et le fantasme. Dans la pratique c’est très différent et en particulier dans la pratique de l’acte. Autant cette histoire de pulsions mène assez rapidement à la question de l’acte, autant l’histoire du fantasme devrait, si vous faites une analyse, vous mener au décryptage de la question du désir inconscient. L’analyse, ce n’est pas la recherche des pulsions. Freud commence par là : si on veut créer une science, il faut des éléments nouveaux. Les éléments nouveaux, pour l’analyse, ce sont les pulsions.
Nous essayons de démarquer un peu les choses : je crois que ce démarquage n’est pas vraiment fait par Freud. Le démarquage, c’est vraiment le séminaire XI de Lacan. C’est un problème difficile parce que Freud dans un premier temps (dans l’Abrégé de Psychanalyse, il y a trois pages sur l’histoire des pulsions) dit qu’il y a d’un côté le montage de la pulsion et de l’autre le cheminement de l’amour. Il suffit de lire un texte de Freud où on trouve tout : « Un enfant est battu ».
Dans « Un enfant est battu », vous avez toute la logique algorithmique de ce qui se passe du côté du fantasme. À partir de l’œdipe, il vous montre comment le fantasme se constitue. Et Lacan, quand il va travailler la logique du fantasme, s’appuie bel et bien sur Freud pour montrer que c’est une dynamique. On est dans le mouvement de la question œdipienne, et c’est là où Lacan va introduire de son côté le S barré losange de petit a, S <> a. Le S c’est quand même ce qui se passe entre deux signifiants. Le signifiant, à cet endroit, représente le sujet pour un autre signifiant. Il n’y a pas de sujet chez Freud. Ichspaltung, c’est le clivage du Je et pas le clivage du sujet. La question du sujet est introduite par Lacan. S <> a, ça veut dire qu’il y a du sujet. Le sujet est clivé, le sujet est pris entre deux signifiants ; Pendant votre analyse, il est où votre sujet ? S’il y a une Durcharbeitung, c’est que l’on attend le prochain signifiant ? Sinon, si ça s’arrête, ça va donner du symptôme. Le symptôme, c’est un signifiant qui s’est arrêté. Le symptôme lui-même va prendre soit un signifiant soit une séquence signifiante. Quel est le rapport avec le fantasme ? Le symptôme lui-même va utiliser le fantasme pour constituer une espèce de structure qui va vous ennuyer pendant longtemps, qui va créer le symptôme. Lacan dit qu’il n’y a de pulsions que partielles, il n’y a pas de pulsions globales. Ce qui est un autre problème que la question des pulsions de mort, de l’Éros et Thanatos. Les pulsions elles-mêmes sont partielles. Autrement dit, notre histoire de stade du miroir, c’est déjà une reconstitution sympathique, ça met déjà en place des quantités de pulsions qui se promènent. Quand vous voyez des gens bien, qui sont bourgeoisement installés, avec un petit chien, une jolie maison, et que vous apprenez que le soir ils vont dans des pissotières par exemple… ils vont bien… mais à côté de cela il y a des pulsions… ça veut dire que l’histoire du fantasme et des pulsions ça ne marche pas si bien ensemble.
Lacan propose une formulation dans le graphe : la pulsion partielle c’est S <> D, c’est là où le sujet s’évanouit dans la demande, D. Donc il faut qu’il y ait une demande de l’autre. On n’a encore rien dit de la demande de l’Autre. Il y a quand même la question du sujet. Alors, dit Lacan : vous allez dire qu’il n’y a pas de sujet ? Si, il y a du sujet, mais alors qu’est-ce que c’est le sujet ? Est-ce que c’est le même sujet que le sujet du désir ? Non, ce n’est pas le même sujet, c’est le sujet acéphale, sans tête. La question se posera alors de savoir comment s’articule le fantasme inconscient avec les pulsions ? Et là on n’a pas de réponse. À quel moment, dans le fantasme inconscient, allez-vous mobiliser un scénario qui serait pulsionnel ? C’est-à-dire que dans votre fonctionnement, à un certain moment, il y a quelque chose qui vous échappe. Alors bien sûr, il faudra traiter toute la question de la violence. Dans cette articulation il y a certainement quelque chose qui touche à la violence et à la mort, et à la déshumanisation elle-même. Comment des gens arrivent-ils à se démarquer complètement de l’humanité de l’autre ? Comment cette déshumanisation est possible ?
Les objets de la pulsion, c’est important pour Freud. Autant on a des problèmes du côté de l’articulation ente fantasme et pulsion, autant les objets de pulsions sont des constantes. Il y a là toute la question du sein, des seins… le sein revient souvent quand même. Il y a aussi toute l’histoire de la psychanalyse avec Fliess… lui il adorait le nez ! Le pénis évidemment… mais il faut tenir compte aussi de la place du regard.
Donc, la structure de la pulsion, c’est un montage. Je suis d’accord pour suivre Lacan dans ce sens. Et pourquoi pas un montage surréaliste ? il y aurait un lien avec le livre qui va paraître sur les fins d’analyse, Fin de cure(s) et fin d’analyse(s). Je pense que les fins d’analyse vont provoquer un nouveau rapport aux pulsions.
Lacan rajoute que cela passe par des références grammaticales, la mise en place du collage surréaliste. Voici l’image que donne Lacan de cette histoire de montage, c’est « la marche d’une dynamo branchée dans la prise de gaz, une plume de paon en sort et vient chatouiller la vérité d’une jolie femme qui est là à demeure pour la beauté de la chose ». Il y a quelque chose dans la pulsion, et c’est l’essentiel, c’est le dessin topologique de l’histoire de la pulsion. Et cette histoire d’objet a c’est quoi ? C’est la pulsion elle-même qui tourne autour de l’objet, elle ne happe pas l’objet, elle n’arrête pas l’objet, elle tourne autour. même Freud a dessiné cela, mais il ne parle pas d’objet a. Pour le fantasme c’est différent, c’est l’aliénation et la séparation.
Quand Freud va reprendre l’histoire de la théorie des pulsions, il va dire une phrase que je trouve tout à fait énigmatique qui, elle, se situe du côté des pulsions de vie et des pulsions de mort : « Le Ça néglige la conservation de la vie comme la protection contre les dangers. Quant au Surmoi, bien qu’il représente d’autres besoins encore, sa tâche essentielle consiste toujours à réfréner les satisfactions ». Donc il y a une espèce de combat fondamental chez l’être parlant entre le Ça – on là retombe sur la deuxième topique, sur la question d’« Au-delà du principe de plaisir » – il y a une lutte entre le Ça et le Surmoi.
Quand Freud parle de pervers polymorphe, il parle déjà de plusieurs pulsions qui sont ensemble, on n’a pas une seule pulsion, c’est la première chose.
Quand Freud va aborder la question de l’amour, c’est avant tout pour dire que ce dont l’humain a à se débarrasser, pour faire une analyse, c’est de l’auto-érotisme. C’est au fond ce qui nous cramponne, c’est ce qui nous arrête. Mais là où je trouve une réponse partielle, c’est ce que dit Lacan à la fin de La logique du fantasme, séminaire extrêmement compliqué ; en dernière page, il dit que la question du fantasme, c’est simple : le scénario fantasmatique c’est une axiomatique ! Ce n’est pas quelque chose qui bouge, c’est le point dont vous partez et le point sur lequel vous allez tomber. Et là c’est intéressant, parce que qu’est-ce qui différencie alors cette axiomatique fantasmatique de ce scénario pulsionnel dont on dit en plus qu’il n’y a que des pulsions partielles. Là-dessus va se jouer toute la question du voile. Comment tout cela est voilé ? Il n’y a pas seulement l’articulation entre le fantasme et les pulsions, il y a aussi comment tout cela est voilé, comment tout cela est couvert, ce qui pose une autre question que Freud a lancée (et que je n’ai pas compris), qui est le principe de constance.