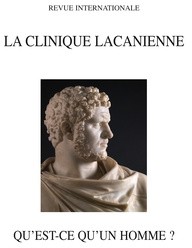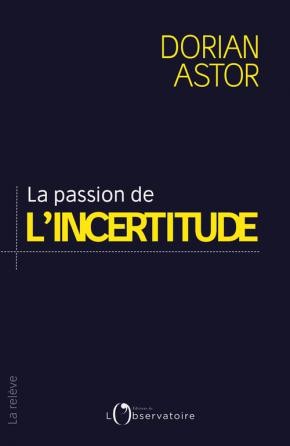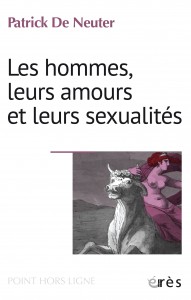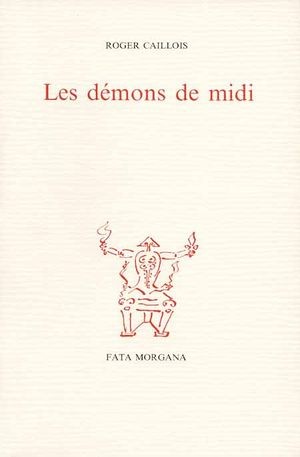Tapez pour saisir le texte
Patrick DE NEUTER
« Les hommes, leurs amours et leurs sexualités » (2021),
Coll. Point Hors ligne, Editions Erès 272 pages.
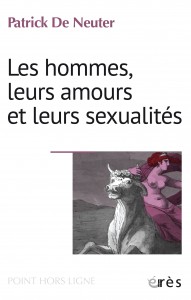
Cet ouvrage est un essai sur les désirs et les fantasmes chez les hommes que nous offre Patrick De Neuter à partir de l’étude du mythe de l’enlèvement d’Europe dans un style rigoureusement didactique. Un second tome, qui sortira prochainement, va s’attacher à déployer le versant féminin de la question. A partir d’une longue et riche pratique auprès des couples, il pose l’idée d’une forme d’archaïsme dans les comportements sexuels des hommes dans les liens hommes-femmes par la mise en place d’une forme de domination masculine faisant la part belle aux infidélités. Si la place du modèle patriarcal se trouve repérée et sa chute reconnue, le propos ne fait qu’effleurer la question. L’enjeu n’est pas pour nous de détailler l’ensemble des thématiques développées mais de reprendre les traits saillants et significatifs de son propos à savoir la richesse des mythes, la scène que propose le couple pour dire le désir des hommes et la dialectique des fantasmes de virginité et du démon de midi.
« Par contre, il serait aberrant d’isoler complètement notre champ et de nous refuser à voir ce qui, dans celui-ci, est non pas analogue mais directement en connexion, en prise, embrayé, avec une réalité qui nous est accessible par d’autres disciplines, d’autres sciences humaines. Etablir ces connexions me semblent indispensable pour bien situer notre domaine, et même simplement pour nous y retrouver. »
J. Lacan, Le séminaire : La relation d’objet, Paris : Seuil, p.252.
La force des mythes
Nous devons d’emblée signaler l’appui renouvelé des mythes pour comprendre la psyché humaine et les liens qui se tissent entre eux. Ainsi, l’auteur réintroduit l’importance majeure des mythes (p. 29-40) pour la psychanalyse dans son étude de l’inconscient dans une mise en re?cit des de?sirs et fantasmes qui traversent toute société humaine. Pouvoir distinguer un contenu latent d’un discours manifeste d’un texte permet de décrypter l’implicite d’une société donnée, le refoulé d’une culture. Pour cela, il reprend finement le mythe de l’enlèvement d’Europe qu’il arrime justement aux mythes du Minotaure et de Cadmé. Pour rappel, le premier nous renvoie à l’enlèvement d’Europe par Zeus, son arrière-arrière-grand-père, transformé en taureau dans un souci de séduire la jeune fille. Le second évoque la vengeance de Poséidon à l’encontre de Minos. Il envoie donc un taureau séduire la femme du roi de Crête, Pasiphaé qui donnerait la vie au Minotaure, créature mi-homme, mi-taureau, qui sera détenu à l’intérieur d’un labyrinthe élaboré par Dédale. Le dernier volet renvoie à l’histoire des frères d’Europe à sa recherche. Entrant plus en avant dans le mythe d’Europe, nous sommes invités à explorer les facettes de la figure de Zeus à la fois support de projection d’un homme tout-puissant, d’un époux, d’un amant et d’un père à partir du foisonnement de ses objets sexuels (une cinquantaine !) qu’il séduit aisément chez les déesses et les humains dans la crainte de son épouse, la déesse Héra.
Les hommes et l’autre scène du couple
La psychopathologie du couple se retrouve en filigrane tout au long de cet essai avec la mise en lumière des étapes décisives d’une dynamique familiale, des temporalités diverses que peuvent traverser le couple à savoir la promesse d’un enfant, les avatars de la vie sexuelle au gré des saisons de la vie, la différence d’âge et le démon de midi. Pour De Neuter et différentes études sociologiques à l’appui, les causes de l’infidélité masculine renvoient à une recherche de réassurance narcissique, une insatisfaction, une lutte contre le vieillissement et la mort. En somme, il y voit une tentative de lutte contre l’angoisse de castration. Cet ouvrage tend à vouloir aborder les sexualités et les amours chez les hommes à partir du prisme (bien étroit) du couple hétérosexuel n’étant pas pris dans des questionnements autour de la non-binarité, la transidentités et les modulations actuelles autour du choix d’objet, des objets de choix. De Neuter s’appuie sur le couple divin Zeus-Héra pour nous enjoindre à penser le couple à partir du paradoxe de la fidélité. Il nous vient tout de même une question : où situer la castration chez le souverain des dieux olympiens ? Dans son questionnement autour de la clinique du couple, l’apparition de la notion de séduction, même si elle nous laisse sur notre faim quant à l’absence de dialectique avec le versant féminin, trouve à notre sens un intérêt à souligner dans l’articulation qu’il produit du côté des modalités de réassurances narcissiques. Séduire et conquérir sont ainsi des possibilités déterminantes de l’hypervirilité afin de regonfler la baudruche narcissique d’hommes aux prises avec une angoisse de castration toujours insupportable dans une société d’hyperconsommation. L’angoisse de castration trouve d’ailleurs des modalités symptomatiques du côté de symptômes sexuels. De l’autre côté, le thérapeute de couple est-il nécessairement le garant, le gardien de la pérennité du couple en thérapie ?
Tempes grisonnants et démon de midi.
Si le mythe trouve sa pertinence dans l’étude de l’inconscient, l’auteur s’en saisit à partir d’indices qui lui permettent d’éclairer pour une part des fragments psychiques réprimés ou refoulés. Son hypothèse est la suivante : « le ravissement toujours actuel provoqué par le mythe de l’enlèvement d’Europe tient au fait qu’à la lecture de ses diverses versions et à la contemplation des mosaïques, peintures, sculptures et autres œuvres d’art, qu’il a inspirées, nous découvrons des désirs inconnus ou connus, mais réprimés parce qu’ils ne correspondent pas à nos idéaux ou parce qu’ils contreviennent à nos interdits individuels, familiaux ou sociaux. » (De Neuter, 2021, p.36).
La thématique des tempes grisonnantes nous invite à relire l’ouvrage « Les démons de midi » (1991) de Roger Caillois. C’est sa thèse publiée initialement dans la Revue d’histoire des religions en 1937 où il soutient l’idée que les dieux et les démons apparaissent à midi
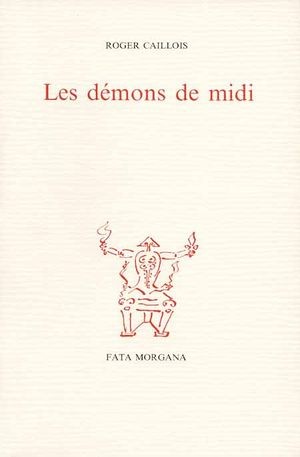
et non à minuit. Cet ouvrage propose un examen érudit de la mythologie méditerranéenne. Avec toute sa verve et sa culture, Caillois nous entraîne vers un périple foisonnant où il explore les éléments constituant l’heure de midi, les liens entre midi et les démons en tout genre (des sirènes, des lotophages et des cigales, des nymphes, des incubes et des succubes), pour cheminer pas à pas sur les terres du démon de midi et de ses origines bibliques. Il y explore l’influence de l’heure de midi sur la sensibilité humaine. Le démon de midi renvoie au texte des Psaumes 91, verset 6 où la mention suivante est indiquée : « dévastation qui sévit à l’heure de midi » (Caillois, 1991, p.82). Pour Caillois, c’est l’influence du christianisme qui a conduit à la décadence de l’heure de midi à partir de la qualification morale de la lumière et des ténèbres dans une manichéisme exacerbé.
Pour De Neuter, la figure de Zeus permet à nouveau de déplier les différentes strates du complexe paternel mais elle semble également renvoyer à un profond désir des hommes d’âge mûr. Chemin faisant, le mythe de l’enlèvement d’Europe permet d’aborder des désirs inconscients qui peuvent trouver des échos avec la vie psychique et l’auteur croit pouvoir traiter d’une configuration de couple assez spécifique et délimitée à savoir l’homme d’âge mur et la jeune fille. Ce mythe semble faire l’écho des rêves et des idéaux des hommes de l’époque et l’auteur croit pouvoir y repérer une revendication masculine d’être désirant d’un objet cause de leur désir et non d’être situé à la place de l’objet de désir tout en se décalant de l’image maternelle toute-puissance générant une potentielle angoisse de castration destructrice pour l’assise narcissique. « L’inconscient étant insensible à l’érosion du temps qui passe, cet imago maternel archaïque garde en effet toujours un pouvoir angoissant, voire terrifiant, pour le petit garçon que tout homme est encore dans son inconscient, quel que soit son âge. » (De Neuter, 2021, p.65-66). Sous les termes d’infidélité, de tromperie et de séduction, vient à la rescousse la notion de fantasme qui rend compte de la part de répétition dans le désir supposément masculin à partir d’une écriture singulière que porte le sujet. Nous avons été pour un peu surpris de ne pas trouver des thématiques qui traversent notre clinique actuelle dont les homosexualités, les transidentités, la non-binarité. Le mythe de la virilité est un piège qui pose la domination de l’homme sur la femme et sur l’homme contestant ce modèle : certains ne se reconnaissent pas dans les battants, performants, décideurs et militants en tout genre (Gazalé, 2007). S’appuyant sur la figure de la jeune Europe, la thématique de virginité est également introduite par P. De Neuter pour présentifier les mouvements ambivalents d’attraction et de re?pulsion de la jeune fille vierge dans la sexualité d’hommes hétérosexuels jeunes et moins jeunes. L’acte de dépucelage est pour une part devenu un fantasme (Goguel d’Allandons, 2007, p. 971-947) voire un rite de passage dans les adolescences contemporaines. Le lien est justement tracé avec le « tabou de la virginité » (Freud, 1918, p.76) décrit dans plusieurs sociétés pour expliquer la peur chez l’homme de la défloration et des différents indices de féminité. Il nous semble important de donner une dimension contemporaine à la notion de névroses actuelles en prenant en compte ce fantasmes de virginité pouvant provoquer des symptômes sexuels que nous pouvons aisément retrouver dans la clinique adolescente. L’enjeu serait peut-être de spécifier ce lien entre la thématique de la virginité et la posture virile. Enlèvement, rapt et viol est un triptyque que déplie De Neuter pour essayer cerner les différentes traductions et interprétations sous-jacentes du mythe d’Europe et réussit finalement à construire une généalogie de l’enlèvement qui débute de l’Antiquité aux fictions les plus modernes et contemporaines de La belle et la bête et ses différentes versions à King Kong. Chaque une jeune fille sans défense se trouve enlevée par un individu dans toute son animalité ou sa pulsionnalité. L’auteur propose à la fin de son ouvrage l’utilisation d’une distinction dans les versions potentielles de l’enlèvement : l’enlèvement consenti, l’enlèvement par séduction et l’enlèvement par violence.