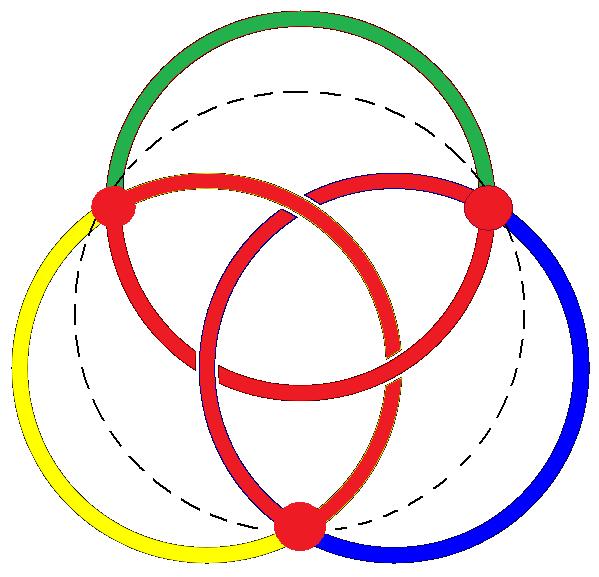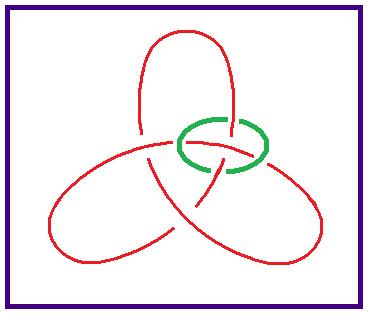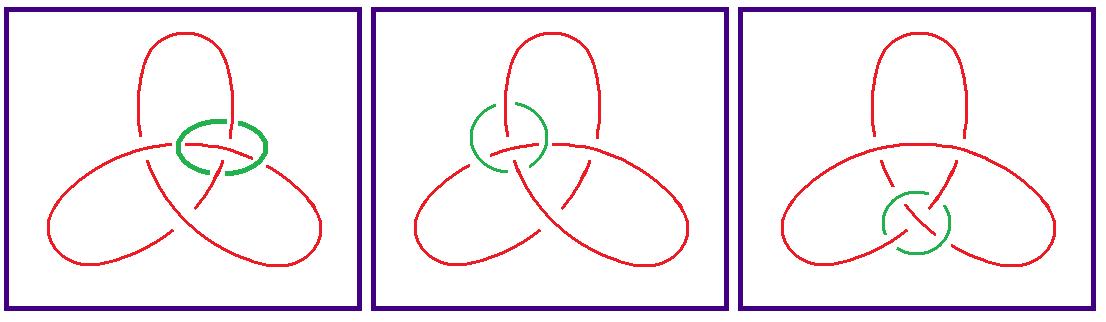Le genre de texte qui peut mettre l’ambiance, entre rire et rogne. Entre un Freud assez brut et un Freud bluffant qui coiffe notre époque au poteau. Un côté « grande tripière » d’habitude attribué à Mélanie Klein.
Est-ce bien raisonnable me dira-t-on en ces temps de sidération tous azimuts, de torpeur sociale, de malaise de la civilisation, et de bascule guerrière, de déterrer ces quelques lièvres, ces quelques marottes à première lecture un peu datées pour nous, alliant considérations anthropologiques d’avant Lévi-Strauss et pragmatisme clinique un peu brut de décoffrage ? N’est-ce pas mettre le feu aux poudres ?
Je crois que les poudres n’ont pas attendu pour prendre feu, sur fond de coups de boutoir sociaux-politiques, et que, au contraire, il faut pouvoir nommer les préjugés, les croyances immatures et la trame archaïque. C’est bien la maxime freudienne reprise à l’Enéide de Virgile : « Si je ne peux fléchir les Dieux d’en haut, je remuerai les Enfers »
Un préjugé, cela semble pourtant une évidence, ne se déconstruit pas uniquement en interdisant de le dire et en punissant, il se prend à bras-le-corps, en assumant un débat, une formation, en réinscrivant l’émancipation des femmes dans son histoire, et la longue traînée de violences faites aux femmes dans l’Histoire, au point que oui, pourra malheureusement se poser pour quelques-unes, la question de pouvoir encore cohabiter avec les hommes. Tout comme l’Afrique du Sud post-Apartheid, avec la commission « Vérité et réconciliation », ou le Rwanda où les Tutsis ont eu à cohabiter avec les Hutus qui avaient massacré leurs proches : cela demande un immense travail individuel et collectif. Et avant d’entendre que « les femmes en font trop », je conseille la lecture de Féminicides, Une histoire mondiale de Christelle Taraud, avec en tête cette question : quelles retrouvailles, quelle alliance, quelle confiance, quel respect restent possibles après cela ? Bien des femmes et des hommes y travaillent et il ne sera jamais établi que remettre la part des femmes et relever la part du sexisme historique en lumière, soit une déclaration de guerre d’un sexe contre un autre. Malgré et tant pis pour celles et ceux qui instrumentaliseraient la revendication féminine pour régler des comptes avec la sexualité voire le désir, ou « canceliser » la culture, il me semble que le féminisme radical, même contestable, haineux ou stérile sur certains bords, n’a encore violé ni tué. En attendant, ce livre-somme, ambitieux, coordonné par Christelle Taraud ayant réuni à la fois des chercheuses, des artistes qui constituent l’Histoire et la culture, des figures internationales, du mouvement social, de la recherche, de l’art ouvre une nouvelle perspective à partir d’une profondeur, et d’une problématique en sciences historiques, ouverte à la discussion autour de ses enjeux : à reprendre certains évènements, de certaines représentations, pratiques ou coutumes, à partir de ce motif du « féminicide », se révèlent nombre de modalités restées refoulées, sous lesquelles s’est exercé et a perduré l’oppression spécifique d’un sexe dans toutes les cultures. La lecture de ce livre constitue une épreuve, l’épreuve d’une histoire inconsidérée, riche, variée et édifiante.
Il m’est avis qu’un séminaire sur la sexualité féminine qui prenne son temps de lire, de penser, de considérer la prise des psychanalystes eux-mêmes et de la théorie psychanalytique dans une culture patriarcale, au lieu de crier un peu vite au loup d’une revanche violente des femmes, relèverait un peu le niveau et œuvrerait à un dépassement.
Sinon quoi, l’idée est-elle d’admettre que l’émancipation des femmes participe dans le fond d’une dégénérescence du symbolique et de la civilisation ? Ou d’une nouvelle plainte hystérique, frigide, revancharde ou irresponsable alors que les temps sont durs ? Ne peut-on pas faire mieux que ça au regard de la situation des femmes dans le monde ? Ou quoi, faut-il considérer qu’un paternalisme éclairé constitue la fin de l’Histoire ou le moins mauvais compromis possible ?
Ce serait l’occasion de nourrir le nouveau pas nécessaire dans l’élaboration psychanalytique du sexe et du genre : à la fois ne pas lésiner dans la découverte d’une bisexualité psychique dont on ne parvient pas à faire signifier les potentiels et les implications au niveau théorique. Mais aussi reconsidérer ce qui tenait peut-être beaucoup à l’inscription culturelle dans une structuration sociale patriarcale et un certain rapport à l’irreprésentable : les tenants et aboutissants d’une assignation du sexe féminin à l’irreprésentable, le fameux irreprésentable du sexe de la femme, auquel tout le monde s’est prêté – passage alors peut-être théoriquement nécessaire dans la reconnaissance des femmes et de leur sexualité, mais qui, me semble-t-il est à reconsidérer au regard des évolutions actuelles. Et puis cette place, effective certes, mais attribuée souvent seulement au féminin du fait des représentations du génital féminin, et qui pour partie pourrait relever d’une construction à rouvrir et dépasser aujourd’hui : le « passif », l’oblativité, les fantasmes de viol, d’effraction. Si l’on décolle cela du génital féminin, ne découvre-t-on pas très vite des fantasmes présents chez l’homme aussi, a un stade bien plus tabou et angoissé ? Ce texte à sa manière, nous emmène sur cette voie.
***
« Le Tabou de la virginité », ce texte écrit par Freud en 1918, n’est pas aussi direct, bien qu’il y soit question de fantasmes d’une déception féminine potentiellement « tranchante » au premier rapport sexuel. C’est un texte peu connu, peu commenté, mais dont les commentaires soulignent la centralité et notamment dans le développement de ce champ d’élaboration entre anthropologie et psychanalyse.
Et c’est un texte étonnant pour nous aujourd’hui, qui permet de saisir un peu les mouvements contradictoires de Freud concernant ses représentations sur les sexes, les femmes et la sexualité féminine.
De quoi nuancer les travers rapides : justement Freud est inclassable, ni comme réactionnaire, ni comme révolutionnaire, ou un peu des deux, car ce n’est pas son objet, en tout cas pas son objet premier, même s’il a pu s’exprimer sur l’actualité et prendre position par exemple pour une psychanalyse accessible à tous et toutes. Son objet ici concerne les soubassements inconscients archaïques de nos peurs et des mœurs attenantes. Comme il le rappellera tout au long de son travail de fondation de la psychanalyse, elle vise en nous, ce dont « on ne veut rien savoir », ce qui a été refoulé pour être a minima civilisés : « La révolution freudienne découvre le symptôme comme un effet des exigences de la culture contre la satisfaction sexuelle. » Pour les hommes et pour les femmes – mais pas de la même manière.
Et ce texte ne déroge pas à l’ambivalence de sa progression : entre la part où il méconnaît, si ce n’est ses fantasmes, peut-être les représentations parfois grossières pour nous aujourd’hui, avec lesquelles il aborde la sexualité et une psychologie féminine et la part où constamment, et c’est là qu’il fonde un savoir sur le réel et la condition humaine – indéniable aujourd’hui malgré tous les liquidateurs de la psychanalyse – et non une doctrine, Freud critique ses propres réflexions, en repère et considère d’emblée les éventuelles limites, énonce le potentiel illusoire de ses hypothèses. Ainsi, me semble-t-il, malgré certaines affirmations pyromanes de prime abord, il a le mérite d’exhumer des grosses ficelles qui constituent, qu’on le veuille ou non, le préjugé collectif de l’époque sur la sexualité féminine, et pour beaucoup encore aujourd’hui. Le texte de Freud s’appuie sur la clinique et ce dont les analysantes lui ont fait part… certes parfois sans doute, dans l’ignorance de la part de son propre préjugé paternaliste sur la sexualité féminine.
La progression du texte de Freud est en soi remarquable. Sous la forme d’une dérive libre au fil de la théorisation, il se réfère d’abord au savoir scientifique (Krafft-Ebing) anthropologique (Crawley) de son temps, pour poursuivre une autre énigme, que la vérité factuelle ou objective ne va pas résoudre, et même peut-être voiler : il n’y a pas de vérité factuelle objective, parce que le tabou ne se décrète pas. Il se transmet peut-être, mais ne se décrète pas. Freud traque la charge de jouissance du tabou, il cherche de quel insupportable ou impossible désir inconscient le tabou est l’effet et se répète, à l’échelle collective, singulière, même dans une société dite « civilisée ». Il revient ici sur Totem et Tabou, et précise : le but de ce texte n’est pas de revenir sur la nature du tabou qu’il dit avoir saisi de la manière suivante dans Totem et Tabou : le tabou est l’effet d’une « ambivalence originaire ». Où la question de l’inceste prend toute sa place. Mais aussi très certainement, la dimension d’une bisexualité transgenre.
La logique de progression de Freud ne relève pas d’une logique scientifique classique, mais elle met à jour la vérité de l’inconscient, la causalité psychique inconsciente, là où le tabou est effet du réel sexuel. C’est une progression éminemment psychanalytique : Freud passe de la référence scientifique à la clinique psychanalytique, pose sa thèse et approfondit encore par une référence littéraire, un auteur dramatique relisant l’histoire un passage de l’Ancien Testament. Entre littérature et Livre. Je vais essayer d’énoncer en quoi elle est éminemment analytique, mais d’abord, je voudrais souligner d’emblée que l’on perçoit ici que la logique analytique est subversive en elle-même : Freud ne passe pas d’un texte à l’autre par l’analogie. Il ne met pas en équivalence le discours de Crawley et la parole de Hebbel, ces deux textes relèvent d’une autre logique et Freud ne les confond pas, par contre il ne donne pas une prévalence sur le vrai à la science. La littérature est porteuse d’un savoir et d’une vérité, l’artiste outre de nous enchanter nous enseigne. Il passe d’un texte à l’autre parce que ces textes n’ont pas le même rapport à la vérité. Entre la vérité de Crawley, qui touche à établir une connaissance factuelle et objective, anthropologique, la vérité de la Bible, comme mythe organisateur des interdits et des lois, le théâtre d’un écrivain, Hebbel, qui à partir de son fantasme révèle quelque chose de l’origine sexuelle du tabou de la virginité – entre les trois, le passage par la question du « non rapport sexuel » selon l’expression lacanienne, très clairement saisissable ici, même si bien sûr ne pose pas le problème avec ces termes, mais en termes de castration.
Et ce faisant, néanmoins, il subvertit l’ordonnancement culturel dominant : il passe du « civilisé », qui n’est qu’à la surface des choses, pour suivre la piste et débusquer la causalité du côté du primitif. Ainsi, le mythique est plus proche de cette vérité que le factuel historique, car finalement il passe de l’histoire anthropologique, à la clinique, à la dimension biblique avec la référence à Judith et Holopherne, à la poésie – en quoi la Chose du mythe a plus d’effet encore dans l’histoire, dans la répétition historique que la mémoire historique objective des faits ? C’est sans doute que le mythe touche à la structure même du rapport au réel comme impossible ou irreprésentable. C’est aussi important de considérer cette part du savoir de l’inconscient si l’on a à cœur la condition féminine.
Freud finit donc par le singulier de l’œuvre d’art, la pièce de théâtre de Hebbel : là où est représenté et nommé l’enjeu sexuel de l’acte de Judith. Judith se sert de ses pouvoirs de séduction qui confineraient à l’envoûtement pour inviter le chef qui vient d’envahir et d’assiéger sa ville, à un rapport sexuel brutal et éprouvant pour elle, mais qui finira par lui être fatal à lui ; car elle, rassemblant est-il précisé ses dernières forces après un rapport sexuel violent, le décapitera. Nous sommes dans une réinterprétation du texte biblique, Freud le souligne ici, à partir des fantasmes de Hebbel lui-même, partisan identifié à la cause féminine.
Freud cite aussi rapidement une pièce sexiste sous tout rapport, appelée « Le venin de la pucelle ». Sollers, dans sa référence au texte de Freud, ajoute l’invitation à suivre le fil dans la culture, des pucelles célèbres et de ce que ce motif a pu véhiculer voire exciter dans la culture française notamment, avec Jeanne d’Arc, en tête de proue.
Ainsi va la progression des références. Revenons sur la progression problématique.
À l’époque de Freud, et de manière encore très répandue aujourd’hui dans le monde, la virginité concerne le privilège masculin : elle est traitée et considérée comme un bien voire un droit pour l’homme futur époux, avec un contrôle social plus ou moins important sur la validité du mariage à cet égard. Par ailleurs, Freud évoque ce que Krafft-Ebing énonce comme « sujétion sexuelle » qui serait majoritairement celle des femmes : l’épouse restera attachée de manière particulière à celui qui l’a déflorée… Le premier rapport sexuel possède le pouvoir d’assujettir de plaisir, la personne qui goûte pour la première fois à ce plaisir, et les femmes y seraient plus sujettes. Cela symboliserait une dépendance au futur mari.
Freud déloge vite cette hypothèse un peu idéalisée.
– Il se demande en premier lieu pourquoi dans ce cas, chez certains peuples de son époque aux pratiques « primitives », l’acte de défloration est au contraire évité par le futur époux et confié à un tiers souvent représentant institutionnel et/ou religieux. Et plus loin dans ce propos il précisera, avec sa rigueur habituelle : ce qui est « évité » de la défloration au futur époux, n’est pas seulement la réaction à une douleur qui serait infligée dans la réalité par la déchirure de la membrane, mais dans certains rituels, il y a une mise en scène de défloration au sens du coït par le tiers : le tabou ne porte pas seulement sur la peur des conséquences à infliger une douleur physique, mais relève d’une potentielle blessure narcissique ainsi que d’une problématique des effets de connaître un rapport sexuel pour la première fois. À cet égard, il élimine plusieurs hypothèses comme insuffisantes : le tabou de la virginité pourrait être dérivé ou articulé à un autre tabou, celui du sang, notamment par la question des menstruations ou du sang de la défloration. Freud souligne en effet que de nombreux peuples primitifs craignent le sang, et que nombre de conduites et rituels tournent autour du tabou du sang, qui symbolise aussi la mort. Mais cela ne suffit pas.
– Deuxièmement, c’est sans compter sur les bases du savoir mis à jour par Freud avec la psychanalyse : le « premier » choix, le premier investissement libidinal, le premier objet libidinal n’est pas le futur époux, ni la future épouse, mais bien alors pour Freud, le père et/ou la mère, le frère, la sœur etc. Avec cette dimension incestueuse évidemment centrale pour la dimension du refoulement.
– Et Freud à partir de sa clinique remarque que parfois, des femmes trouvent plutôt du plaisir, non pas forcément dans des unions « illégitimes », mais dans des unions secrètes, hors mariage.
À ce titre, l’homme-substitut aux premières figures libidinales peut être porteur d’une déception de manière plus ou moins refoulée, ou supportée, ou sublimée par la partenaire. Ainsi, Freud pose le motif de cette ambivalence de la place de la femme entre sujétion sexuelle et hostilité au premier rapport, avec le premier objet de l’acte sexuel. Dans le cadre de la défloration, celle-ci peut constituer, pas seulement une douleur physique, mais une blessure narcissique, doublée de la déliaison d’une forme d’amertume voire d’agressivité.
Ainsi, s’il y a un tabou pour Freud, c’est toujours au lieu d’un danger ou d’une menace : le tabou de la virginité pourrait ainsi correspondre à une menace de déliaison hostile de la femme au moment de la défloration. C’est la thèse centrale de ce texte. Au passage, à partir de ce matériel clinique recueilli avec quelques patientes après l’abord de leur part, de ce moment de retournement hostile ou injurieux contre leur futur mari, qu’elles aiment et désirent par ailleurs, lors du premier rapport sexuel, Freud tentera d’ailleurs de travailler la question de la frigidité, à partir de là, comme une réaction à la défloration qui resterait à l’état de trace dans la frigidité.
Il revient sur sa théorisation du tabou dans Totem et Tabou et en arrive à cette hypothèse concernant le Tabou de la virginité : le « primitif » craint tout ce qui est inconnu et nouveau, et il y projette des peurs et fantasmes. Toute question d’un tabou vient donc à l’endroit d’une peur. Ici, la peur signale un danger psychique et réel dans certains cas : le premier rapport sexuel pourrait être l’occasion d’une déliaison d’une violence réprimée, liée à la déception de la promesse œdipienne mais pas seulement, aussi de la promesse du plaisir dans l’acte sexuel. Il est intéressant de voir ici, le démêlé un peu plus marqué me semble-t-il qu’ailleurs de Freud avec la nature de ce « danger » réel, imaginaire, légitime ou pas ? La question des pratiques primitives, permet à Freud de saisir quelque chose de peurs et de croyances qui seraient encore projetées à l’extérieur par le « primitif ». L’idée même du « primitif », lui permet d’aller saisir des éléments du désir inconscients non refoulés. Mais Freud dans son texte, revient quelques fois sur ce danger, certes de nature psychique, mais qu’il pense « légitime » de la part de l’homme : le danger, même psychique, est réel.
***
Je lisais pour préparer un cours aux infirmiers, un mémoire de recherche sur la santé et le sexisme. Sans aller ouvrir les questions encore si actuelles de la contraception, de l’excision, de la preuve de défloration par le sang au moment du mariage etc., quelques exemples très proches de nous ici en France m’ont surprise : par exemple les termes de l’anatomie féminine. Elle cite plusieurs exemples : « l’hymen est le nom d’un cri rituel poussé lors du mariage dans l’Antiquité, par glissement le terme est devenu synonyme de mariage », liant ainsi le terme désignant le mariage à une défloration supposée au premier rapport sexuel. Elle évoque un nerf qui va du pelvis au périnée et se prolonge en se divisant en trois (nerf dorsal du clitoris, nerf périnéal, nerf rectal inférieur) qui était anciennement appelé le « nerf honteux », et reste aujourd’hui « nerf pudendal », de pundendus, a, um « ce dont on doit rougir, ce qui est honteux, infâme, immonde », le « vagin », qui vient de l’idée de fourreau du glaive », sans parler de l’exemple du clitoris, qui ne sera découvert dans sa totalité qu’en 2009 par la gynécologue Odile Buisson, et n’apparaîtra dans un manuel scolaire qu’en 2017.
Dans ce mémoire, l’auteure rappelle aussi, cette pratique du « point du mari » : nom donné à des points de suture post-partum, proposés voire fortement recommandés par certains médecins aux femmes après leur accouchement, pour resserrer l’entrée du vagin au regard de la satisfaction sexuelle du « mari », et sans information très souvent, sur les effets secondaires parfois très douloureux de cette pratique. Et au fil de son raisonnement, sur différents plans, les exemples sont aussi nombreux que surprenants parfois. Comment le contrôle reste impensé et actif, autour d’un préjugé sur la douleur des femmes et d’une ignorance du plaisir féminin.
S’il n’est pas pris au pied de la lettre d’une vindicte liquidatrice, ce texte garde la puissance d’aller aborder les sujets qui fâchent pour les mettre en débat, et de façon assez pragmatique et intéressante pour l’analyse et la clinique : Freud fait apparaître une problématique de l’avoir ou pas, pour la femme, si la défloration doit être pensée comme « blessure narcissique », mais surtout encore pour l’homme, qui « a le droit » à sa défloration, à son hymen ou pas. Par ailleurs, en parlant du « Tabou de la virginité » évoque le motif d’une réaction divisée des femmes au premier rapport sexuel, entre « sujétion » et déception hostile, et c’est d’une potentielle violence féminine dont il fait état, à partir de certaines situations cliniques. En tous les cas d’une violence refoulée. On pourrait se dire que quand même, au vu du prorata voire du monopole de la violence historiquement, est-ce du côté féminin qu’il faut aller déminer le terrain en priorité ? Et se dire que, quand il évoque ces désirs de castration archaïques des femmes, il s’agit bien souvent, non pas de la réalité d’une menace, mais de l’angoisse de castration des hommes et de leur violence historiquement organisée ou légitimée. Il n’empêche que Freud permet ici le dévoilement de certaines représentations dont le statut n’est pas bien clair, entre constructions anthropologiques de la culture et fantasmes fondamentaux. Au détour d’un texte qui semble fait aussi de grosses bourdes sur le féminin, Freud met à jour toute la puissance de la menace de castration. À plusieurs égards, là où il crée certes ébullition, aberration ou confusion, apparaissent aussi les points de clivage des plans, entre fantasmes et mœurs, fantasmes et préjugés, fantasmes et désirs dans la réalité, pulsions, interdits socio-culturels et légitimité.
Cette dimension est un axe de travail, dans les frictions entre champs psychanalytiques et les autres champs. Faut-il le rappeler ? Un fantasme de viol, n’a rien à voir avec un « désir » de viol dans la réalité, encore moins avec une légitimation sur un mode pervers. Quand on évoque par exemple la passivité féminine, le fantasme de défaite, comme je l’ai vu dans certains textes, la question de l’inconscient n’est pas sexiste, mais jusqu’où peut-on affirmer qu’un certain réel de l’organisation génitale, ou plutôt érogène, détermine la modalité des fantasmes de façon sexuée ou genrée et déterminerait d’ailleurs une légitimation d’un certain savoir sur la jouissance qui s’impose.
Je pense qu’il y a du travail à faire. Sur notre part aussi, en tant qu’analystes, « dans le désordre dont [on] se plaint ». Et que pour préserver l’effectivité de notre champ, nous aurons mieux fait de lier-séparer, la part qui concerne l’inconscient comme réel, les fantasmes, de la part éventuelle du préjugé patriarcal au particulier de la pratique ou dans la théorie psychanalytique. Sachant qu’un trait de notre époque certes mis à mal par la période COVID, est peut-être que l’on croit que l’on ne croit plus : on croit que l’on a dépassé cela, on croit que cela est archaïque, et ce faisant, l’insu est rejeté à l’extérieur et nous revient du réel comme des bombes.
Alors comme y invitent les Femens avec humour, résistons : « Boobs, not bombs » !