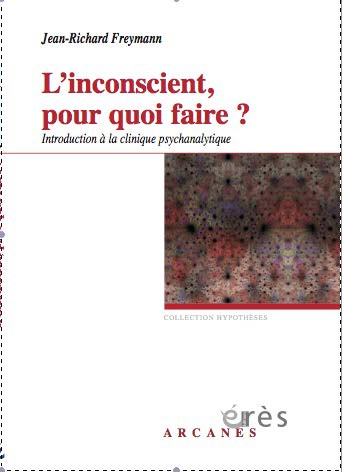Intervention de Jean-Richard Freymann dans le cadre des Journées de la FDCMPP « Le malentendu comme espace de créativité » qui a eu lieu le 14 juin 2018.
Introduction
Je dois tout d’abord vous remercier de m’avoir invité à parler à cette journée « Le malentendu, un espace de créativité ». J’en suis d’autant plus flatté que si j’ai adressé bien des jeunes patients au CMPP, je n’ai jamais souhaité y travailler. Et Dieu sait qu’à « la belle époque » les « luttes étaient ardentes et noires » à Strasbourg. Je me rappelle quelques échanges avec Jean-Pierre Bauer, Jean-Pierre Dreyfuss, Daniel Michel, Françoise Coret et bien d’autres qui posaient toujours des questions à propos de l’articulation entre le champ analytique, le champ institutionnel du CMPP et le travail à plusieurs voix des différentes spécialités. Avec la question insistante de savoir en quoi le directeur d’une institution vient à donner le diapason à ladite institution. Alors quelle place laisse-t-on à l’enfant entre les exigences de l’État, l’œcuménisme des soignants ? Comment entendre les malentendus fondamentaux ?
Pour y répondre à ma manière, j’ai donné deux titres : « Comment entendre le malentendu ? »
et une sorte d’interrogation répondante : « Peut-on créer de la métaphore poétique ? » chez l’enfant pris en charge. Aujourd’hui j’ai une question supplémentaire : « Comment l’enfant peut-il entendre que, au lieu de l’écouter, on le prenne d’emblée dans des évaluations pluricéphales et dans quelques slogans véhiculés dans les nosographies actuelles et dans les réseaux sociaux ? »
Le problème basal qui se pose – vu à partir de mon champ, l’analytique – c’est que pour qu’il y ait de la psychanalyse, il faut qu’il y ait du psychanalyste, quel que soit le lieu.
Pour élargir le propos de Moustapha Safouan1, nous faisons part d’une écoute bien particulière, celle qui articule le(s) transfert(s) à une forme de désir de l’analyste. Pendant longtemps cette exigence éthique était respectée dans les CMPP. Si elle ne l’est pas, nous retombons dans le langage commun, dans les slogans des DSM… et dans la mise en place de mots d’ordre lancés par l’État.
J’ai l’outrecuidance d’affirmer que le combat continue quelle que soit l’institution où vous travaillez, justement autour de ce malentendu qui pourrait se dire : entre ce que l’on attend de vous et ce que vous êtes prêts à soutenir. Vous connaissez peut-être la formule de Lacan : « Il ne faut pas céder sur son désir », mais encore faut-il savoir un peu quelque chose sur son désir… son désir inconscient.
De mémoire je cite (à peu près) Jean-Pierre Bauer qui disait qu’il ne faut pas confondre compromis et compromission.
- Le compromis, c’est une formation symptomatique. Il s’agit d’apporter son petit savoir-faire face aux restrictions faites par la réalité. Un conflit qui ne peut mener qu’à la formation de symptômes et qui rejoue souvent ce que l’enfant vit par rapport à sa famille et ses proches. Et c’est justement un certain clivage du Moi et à la castration de l’Autre. C’est à cet endroit-là qu’il y a la question du « désir de durer » qui n’est pas obligatoirement celui de s’éterniser.
- Par contre la compromission c’est de s’identifier au discours ambiant et aussi d’empêcher tout effet de nouvelle transmission… c’est-à-dire toujours énigmatique.
Ordre familial et inconscient
Je tiens à vous donner un superbe développement de Lacan sur le malentendu que vous trouvez dans Télévision2: « L’ordre familial ne fait que traduire que le Père n’est pas le géniteur, et que la Mère reste contaminer la femme pour le petit d’homme ; le reste s’ensuit. » Alors jusqu’à quel point la prise en charge de l’enfant rejoue-t-elle l’ordre familial ? Et inversement ? Justement qu’on soit capable de faire dérailler cet « ordre familial » et de créer parfois un « nouvel espace de créativité » ?
L’infans, l’enfant, le scolarisé, l’hyperactif, l’enfant autiste… est le reflet de sa conflictualité entre les mythologies familiale et culturelle dans lesquelles il est pris et, si je puis dire, son « mythe individuel » (pour reprendre la formule de Lacan) mais pas seulement du névrosé, du psychotique, du pervers, du surdoué. Le problème est bien que – quoi qu’on en pense et quel que soit l’âge – ce mythe est inconscient, préconscient, subconscient et qu’il doit se constituer dans la cure avec l’enfant, voire dans toute prise en charge.
Et là on ne comprend pas comment on peut faire, comment synthétiser les choses sans la présence quelque part d’un analyste.
Le problème est que l’inconscient (freudien) de l’enfant est en constitution. Déplacement et condensation, métaphore et métonymie sont à fleur de corps et de pensée. Il y a lieu par dessus tout de respecter la dimension des « jeux de l’enfant » qui signifient et mettent justement en acte, ce que Lacan avançait :
- « le Père n’est pas le géniteur »,
- que la thérapeute, « la Mère reste contaminer la femme » et la relation à l’autre pour « le petit d’homme » et pour la petite fille, la plonge souvent très tôt dans l’univers dit de la frérocité.
C’est que l’infans, l’enfant, l’ado sont les premiers passeurs des formations de Lacan :
- « L’inconscient est la trace de ce qui opère pour la constitution du sujet » ;
- « Le désir, c’est le désir de l’Autre ».
Tout enfant doit nous enseigner les virtualités de l’inconscient et non le contraire, même si se pose toujours la question, pas tellement de la suggestion, mais la question de la pédagogie.
Qu’est-ce que le « mythe individuel » ? C’est le fantasme ou la matrice qui permettra la constitution du fantasme et donc des symptômes.
Il n’y a pas de symptômes sans fantasmes, même s’il y a des fantasmes délirants. Pour en savoir plus, il faut vous reporter aux Études sur l’hystérie3 et en particulier à l’état hypnoïde amené par Breuer qui constitue une base de lancement pour ce « mythe individuel ». Mais Freud aboutit à l’idée de « double conscience », pas de « pleine conscience » qui semble bien à la mode.
Différents malentendus
C’est que le « malentendu » est complet autour des symptômes de l’enfant, entre ce dernier et son thérapeute. Je précise par rapport à l’étymologie : « Malentendu attesté en 1558 (1507 comme adjectif « malintentionné »), est formé avec mal, adverbe, et entendu au sens de « compris » ; le mot désigne une divergence d’interprétation entre des personnes qui croyaient s’être bien entendues sur le sens de certains faits ou propos, seul sens retenu (…) bien que malentendu désigne aussi (1600) le désaccord impliqué par cette divergence ; le mot s’emploie en particulier (1894) dans un contexte sentimental4. »
Alors, par rapport à notre « mythologie analytique » actuelle :
- Premier malentendu : tout allait si bien, le transfert était en place, mais « nous nous sommes tant aimés » mais plus ou moins brutalement la relation d’objet se casse, l’enfant refuse à présent d’aller bien, après un premier temps où il s’était si bienscolarisé. Alors sa créativité va s’exprimer par sa singularité : que faire ? Analyser le malentendu.
- Second malentendu : il y avait d’emblée de la non-communication, chacun dans le colloque singulier qui fait divergence. L’un propose un « jeu de l’oie » et l’enfant renverse le bureau. C’est la question du « non-rapport sexuel », il y a d’emblée un tiers menaçant, une divergence.
- Mais il existe un troisième malentendu pour le sujet lui-même, c’est le cas que Freud évoque dans Psychopathologie de la vie quotidienne5, dans le chapitre « Méprises et maladresses ».
Comme exemple il raconte que sur son bureau « se trouvent déposés, toujours à la même place depuis des années et l’un à côté de l’autre, un marteau à réflexes et un diapason ». Alors qu’il était pressé pour prendre le train, il avait mis dans la poche de son pardessus le diapason au lieu du marteau. Le malentendu est inconscient.
Les associations que livre Freud :
- c’est la précipitation ;
- il avait examiné un « enfant idiot », qui ne lâchait pas le diapason.
« S’ensuivrait-il que je sois, moi aussi, un idiot ? (…) la première idée qui me vint à l’esprit à propos de « marteau » (Hammer) est : Chamer « âne » en hébreu). »
- Association à propos d’une consultation qu’il devait faire où le diagnostic oscillait entre SEP (sclérose en plaques) et hystérie (voir aussi « Le rêve de l’injection faite à Irma6 »).
Son interprétation en ce qui concerne le malentendu entre marteau et diapason : « Imbécile, âne que tu es, fais bien attention cette fois et ne pose pas le diagnostic d’hystérie là où il s’agit d’une maladie incurable, comme cela t’est arrivé il y a quelques années dans la même localité chez ce pauvre homme ! »
Alors, pour faire un parallèle symptomatique, nous confondons souvent chez l’enfant le marteau avec le diapason !
Symptômes et malentendus
Dans un dialogue assez restreint entre Jacques Lacan et Jenny Aubry7, Lacan désigne deux rapports aux symptômes de l’enfant, ce qui me semble pertinent ; deux rapports aux symptômes pour lesquels la conduite par rapport au cercle familial doit être différente.
- Les symptômes où c’est l’enfant qui fait symptôme des relations dans la famille. Alors, dans la pratique, les échanges avec les membres de la famille sont nécessaires.
- Les symptômes dont l’enfant lui-même est porteur (phobie, obsession, conversion…) où se pose manifestement la question de la psychanalyse de l’enfant.
Je dirais que les choses sont le plus souvent tressées par ces deux pôles. Mais faut-il encore repérer un minimum les malentendus fondamentaux qui gouvernent la famille. La difficulté n’est pas de remettre en cause la validité des méandres du complexe d’Œdipe, ou du stade du miroir, ni de délirer sur le fait que nous serions dans une société sans mythes, mais d’articuler les choses par rapport à cette mythologie particulière articulée avec le « roman familial8 » et le discours ambiant, ainsi qu’avec la culture originelle et les langues dans lesquelles on a été pris. La créativité se fait au prix d’un repérage minimum.
Le Malentendu d’Albert Camus
On retrouve tout cela dans une pièce d’Albert Camus qui s’intitule Le Malentendu, pièce publiée à la suite de Caligula9. Le Malentendu s’étaye sur la dimension traumatique et tragique et sur une certaine lecture meurtrière et oublieuse du complexe d’Œdipe… en particulier celui du garçon. Je résume : c’est l’histoire d’un couple maudit, celui de la Mère et de sa fille Martha (Maria Casarès) qui exploitent une auberge dans un coin perdu et qui ont pris l’habitude, depuis la disparition du père, de tuer les voyageurs en deux temps, en leur faisant boire un thé anesthésiant, puis en les noyant dans un étang après les avoir pillés.
En parallèle vient à l’auberge – après vingt ans de disparition – le fils Jan qui, culpabilisé par sa fuite d’alors, voudrait leur donner du bonheur et de l’argent. Il arrive avec sa femme Maria qui l’aime et qui ne comprend pas sa démarche (1er malentendu) et qui finalement accepte de le laisser seul dans l’auberge.
Jan se présente – mais comme Goethe par rapport à Frédérique Brion10 – il avance voilé et ne dit rien de sa démarche. Et, physiquement, après tout ce temps, on ne le reconnaît plus (2e malentendu).
Jan essaie de parler à sa sœur, mais celle-ci ne veut rien savoir puisque on tue plus facilement quelqu’un que l’on ne connaît pas. La mère hésite, mais Martha arrive à la convaincre et suit la procédure habituelle, on l’endort avec le thé (la mère arrive trop tard) et on le jette à l’eau.
À la vue du passeport de Jan, la mère se fait de vifs reproches, qui occasionnent une violente dispute avec Martha, et se suicide ; la sœur Martha est pleine de haine pour son frère et pour sa mère, qui préfère le fils !
La dernière scène garde ce goût d’horreur puisque Maria vient voir Martha qui lui raconte par le menu l’assassinat. Martha est non seulement dans la haine mais aussi dans la frérocité. La dernière scène de la pièce signe le vide « existentiel ».
Le vieux, d’uns voix nette et ferme. « Vous m’avez appelé ? »
Maria, se tournant vers lui : « Oh, je ne sais pas ! Mais aidez-moi, car j’ai besoin qu’on m’aide. Ayez pitié et consentez à m’aider… »
Le vieux, de la même voix. : « Non ! »
Bien entendu ! Et malentendu
Enfant ou pas, il y a un malentendu fondamental qui est dû à l’attente différente des deux interlocuteurs de tout dialogue. De ce point de vue là, les positions dans une consultation ne sont pas symétriques. C’est cette non-symétrie qui est un malentendu qui doit être repris par les différentes techniques. On passe de la technique à la création, dès lors que l’on met en place la techne, c’est- à-dire l’art. Autrement dit, de pouvoir véritablement donner la parole à l’autre, quitte à ce qu’il ne parle pas. Jusqu’où est-on capable de ne pas rester dans les protocoles pour permettre des déviations, des déménagements, des circuits parallèles ? Mais il ne suffit pas de dénoncer les protocoles, même s’ils prennent de plus en plus de place. Un transfert négatif est aussi un transfert. Et il faut savoir que le transfert chez l’enfant ne se situe pas si souvent du côté du sujet-supposé-savoir. Le conflit des attentes (souvent aussi inconscientes) provoque de la haine et du contre- transfert.
À propos du malentendu, Albert Camus fait enseignement :
- Les traumatismes demeurent et l’individu tente toujours de les dénier (par exemple des parents divorcés).
- Le malentendu est que l’on n’entend pas la réalité de ce qui s’est passé. L’oubli est traître et on peut dénier le réel de l’autre.
- La position de la mère, mais aussi celles maternelles que l’on retrouve dans les situations thérapeutiques :
- La mère est sous suggestion de son enfant : elle a tendance à en oublier la loi.
- La mère ne peut pas entendre de la même manière fille et garçon.
- La fonction père et mère n’a pas le même rapport au transgénérationnel.
Ce que dévoile Le Malentendu, c’est bien la pulsion de mort et son intrication ou non avec l’Éros. Retour au Malentendu (p. 247) :
Maria : « Sa mère et sa sœur étaient donc des criminelles ? » Martha : « Oui. »
Maria : toujours avec le même effort. « Aviez-vous appris déjà qu’il était votre frère ? »
Martha : « Si vous voulez le savoir, il y a eu malentendu. Et pour peu que vous connaissiez le monde, vous ne vous en étonnerez pas ».
Conclusion
Toute la question de la création et de la mise en place d’un espace de créativité au sein du CMPP est aussi une question autour de la sublimation ou du refoulement.
Mais comment fait-on ? Comment négocie-t-on la place qui nous est laissée par la mère primitive ?
- Quelle était la position de Jocaste dans Œdipe-Roi ?
- Et dans Le Malentendu, comment à certains moments oublier la jouissance maternelle ?
Bibliographie
J.-R. Freymann, L’inconscient pour quoi faire ? Introduction à la clinique psychanalytique, Toulouse, Arcanes-érès, 2018.
J.-R. Freymann, Éloge de la perte, Arcanes-érès, 2006, réédition 2015.
J.-R. Freymann, Frères humains qui… Essai sur la frérocité, Arcanes-érès, 2003.
A. Camus, Caligula suivi de Le Malentendu, Gallimard, coll. « Livre de poche », 1958.
S. Freud, « Reprises et maladresses », Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Petite Bibliothèque Payot.
J. Lacan, Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001.
M. Safouan, Le transfert et le désir de l’analyste, Paris, Le Seuil, 1988.
1 M. Safouan, Le transfert et le désir de l’analyste, Paris, Le Seuil, 1988.
3 S. Freud ; J. Breuer (1895), Études sur l’hystérie, Paris, Puf, 1956.
5 S. Freud (1901), « Méprises et maladresses », dans Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1992, p. 189-190.
7 J. Lacan, Autres Écrits, Paris, Le Seuil, 2001.
8 Voir S. Freud (1909), « Le roman familial des névrosés », dans Névrose, psychose et perversion, Paris, Puf, 1997.
9 A. Camus, Caligula suivi de Le Malentendu, Paris, Gallimard, coll. « Livre de poche », 1958.
10 J. Lacan (1953), « Le mythe individuel du névrosé », Ornicar ? n°17-18, Paris, 1979.