Vous trouverez ici toutes les notes de lecture et commentaires de textes et d'ouvrages (onglet "tous les articles"). Le groupe du Cabinet de Lecture vous propose son feuillet “Les démêlés", qui articule lectures et réflexions autour d'un livre, et propositions de lectures librement associées - associables. Bonnes libres lectures !
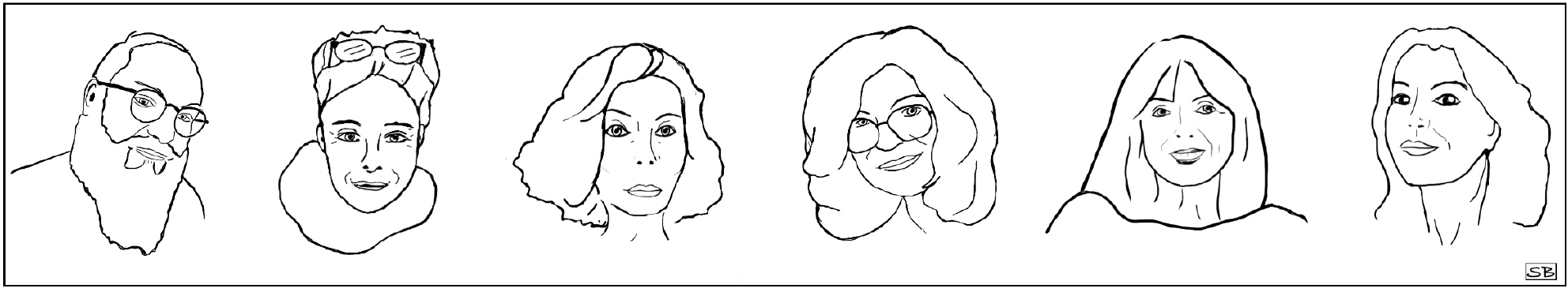
Le numéro du mois
Les Démêlés # 2
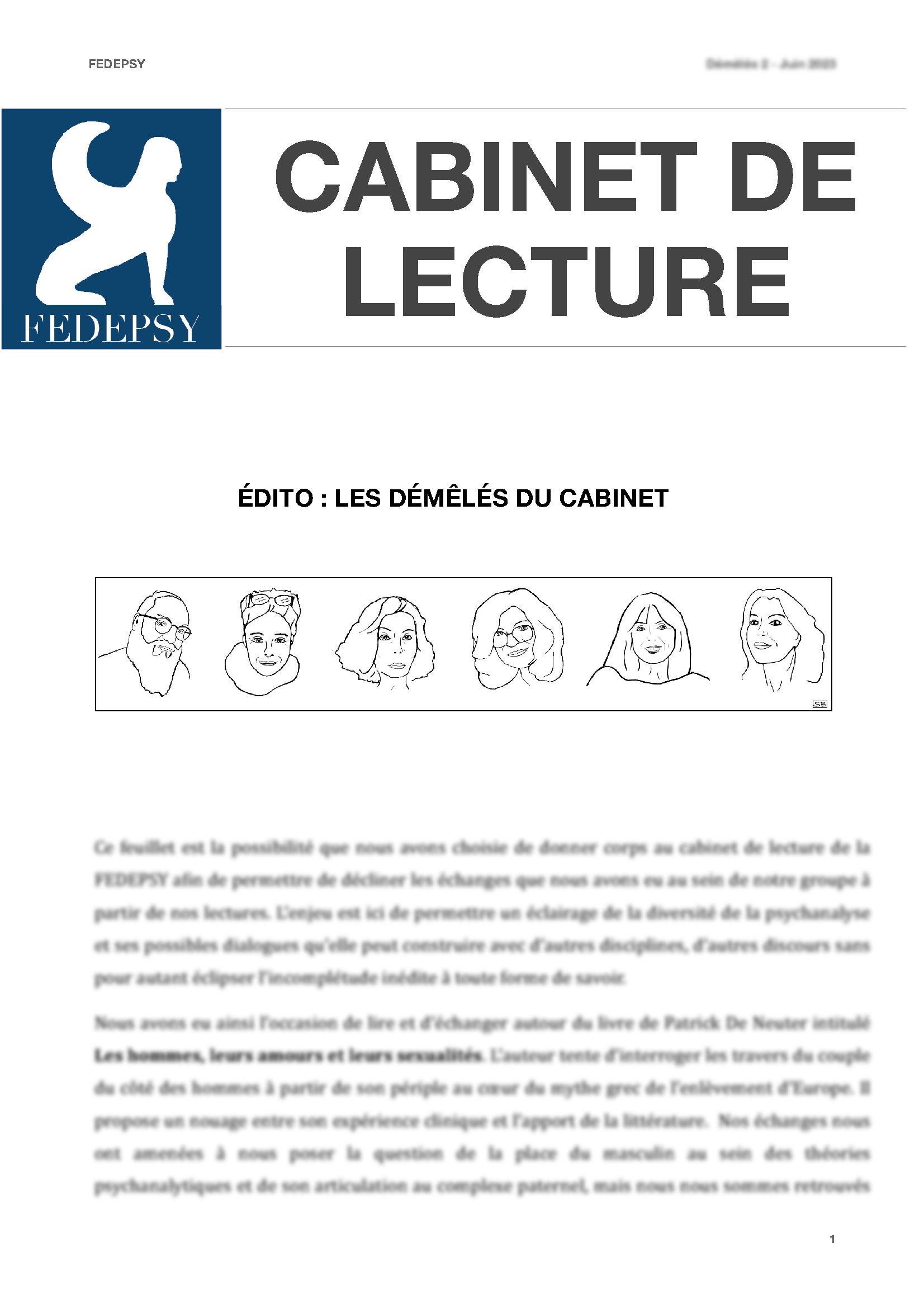 (Cliquez pour accéder à Les Démêlés #2)
(Cliquez pour accéder à Les Démêlés #2)
Sommaire
-
Présentation du feuillet autour du livre « Les hommes, leurs amours et leurs sexualités »
par Stéphane MUTHS
Editorial -
« Les hommes, leurs amours et leurs sexualités » de Patrick DE NEUTER
par Stéphane MUTHS
Cabinet de lecture -
Nos associations de lecture
par Stéphane MUTHS
Livres en lien
Autres parutions des Démêlés
à propos de Sud, d’Antonio Soler, Rivages, 2022
Que ceux qui cherchent des histoires lénifiantes ou édifiantes passent leur chemin ; des histoires avec une morale et de la justice aussi ; des personnages bien typés « gentils » ou « méchants », tout autant. Pas de critique sociale dans « Sud », en tout pas de celles bien appuyées sur les repères classiques déclinant l’évangile selon Marx, Jésus ou n’importe quel autre prophète. « Sud » narre la vie ordinaire de gens ordinaires dans un pays ordinaire occidental. Dans une de ces démocraties comme les haïssent les Poutine, Xi Ping et autres Khamenei, parce qu’elles façonnent selon eux des dégénérés, alibi bien commode pour escamoter leur haine fondamentale de l’Autre, un Autre sensé s’incarner chez nous dans ce qu’on appelle « les Droits de l’Homme », lesquels révèlent immanquablement aussi la part d’ombre de chacun. Or le roman est une des formes que peut prendre cette révélation.
« Sud » est l’histoire ordinaire d’un groupe de gens plus ou moins disparates, plus ou moins liés entre eux (mais c’est sans grande importance) un unique jour d’été dans le sud espagnol, terrassé par le « Terral » un vent sec et chaud passant pour rendre apathiques ceux qui le subissent. En réalité les personnages de Sud sont tout sauf apathiques, tant le livre les cueille au niveau pulsionnel.
Au fur et à mesure de ma lecture du texte[1] de Liliane Goldsztaub, le souvenir d’une lecture a pris forme. En quoi la formation du comédien touche à l’expérience du psychodrame ? L’un parle de donner forme à un texte en l’interprétant, l’autre, de donner forme à un texte qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. « Ed è subito sera » est cette surprise qui surgit dans un donné. Ah oui, je n’avais pas vu cela, et pourtant c’était là !
Notre époque vante l’individualisme, chacun pour soi revendique tous les rayons du soleil rien que pour lui tout seul. Le groupe n’a d’intérêt que s’il met en valeur l’intérêt de l’individu. Les groupes se créent selon l’opportunité. Quand ils se défont, il n’est pas rare que la violence se déchaîne. Chacun avait oublié que ce qui fait lien c’est l’altérité et pas l’essentialisation de la petite différence.
William Conrad[1], sous couvert d’un roman d’espionnage, est un grand livre sur l’influence et sur l’hypnose pratiquée à l’échelle des nations, une pratique qui, avec l’invasion russe en Ukraine et ses conséquences, revient sous les feux de l’actualité.
William Conrad est un jeune homme d’origine polonaise devenu un journaliste célèbre dans son pays d’adoption, l’Angleterre, en raison de ses positions patriotiques au moment de l’entrée en guerre de la Grande Bretagne contre les forces nazies. À tel point qu’on lui confie bientôt, au sommet de l’état, la rédaction d’articles encourageant l’effort de guerre et le patriotisme du pays. Il a fait ses études dans une prestigieuse université anglaise, son meilleur ami est un jeune idéaliste qui ne tardera pas à s’engager dans la lutte en Orient contre les Japonais et il est reçu et protégé dans un cercle très influent proche du gouvernement. Il paraît s’acquitter du rôle qui lui est confié, celui d’être propagandiste de la politique de Churchill avec brio et dévouement. Seulement en réalité William Conrad est un agent d’influence nazi dont la mission est de s’élever au sein de la hiérarchie anglaise pour la subvertir de l’intérieur. Une première étape impeccablement accomplie, puisque William Conrad est devenu tellement populaire qu’il reçoit de nombreuses lettres d’admirateurs et d’admiratrices de tout le pays.
Freud avait mis en lumière une question déterminante dans son cheminement qu’est-ce qu’un père ? De Neuter offre un parcours non dénoué d’intérêt et d’une foisonnante culture. Freud avait tenté de répondre à une question qui jalonne son cheminement avec une forte insistance : qu’est-ce qu’un père ? De Neuter propose des variations autour d’une autre question qui s’exprime peut-être à son insu, dans les multiples plis de son propos faisant fi de toute réflexion autour du genre, et même de toute forme de bisexualité psychique. Qu’est-ce qu’un homme ?
Le numéro 29 de la revue « La clinique lacanienne » nous permet ainsi de prolonger la réflexion vers d’autres sentiers.
Autre texte, perspectives. « La passion de l’incertitude » (2020) de Dorian Astor nous offre également à penser hors de tout manichéisme ambiant.
Ce feuillet est la possibilité que nous avons choisie de donner corps au cabinet de lecture de la FEDEPSY afin de permettre de décliner les échanges que nous avons eu au sein de notre groupe à partir de nos lectures. L’enjeu est ici de permettre un éclairage de la diversité de la psychanalyse et ses possibles dialogues qu’elle peut construire avec d’autres disciplines, d’autres discours sans pour autant éclipser l’incomplétude inédite à toute forme de savoir.
Nous avons eu ainsi l’occasion de lire et d’échanger autour du livre de Patrick De Neuter intitulé Les hommes, leurs amours et leurs sexualités. L’auteur tente d’interroger les travers du couple du côté des hommes à partir de son périple au cœur du mythe grec de l’enlèvement d’Europe. Il propose un nouage entre son expérience clinique et l’apport de la littérature. Nos échanges nous ont amenées à nous poser la question de la place du masculin au sein des théories psychanalytiques et de son articulation au complexe paternel, mais nous nous sommes retrouvés face à une énigme déguisée en une certitude : qu’est-ce qu’un homme ?
Cet ouvrage est un essai sur les désirs et les fantasmes chez les hommes que nous offre Patrick De Neuter à partir de l’étude du mythe de l’enlèvement d’Europe dans un style rigoureusement didactique. Un second tome, qui sortira prochainement, va s’attacher à déployer le versant féminin de la question. A partir d’une longue et riche pratique auprès des couples, il pose l’idée d’une forme d’archaïsme dans les comportements sexuels des hommes dans les liens hommes-femmes par la mise en place d’une forme de domination masculine faisant la part belle aux infidélités. Si la place du modèle patriarcal se trouve repérée et sa chute reconnue, le propos ne fait qu’effleurer la question. L’enjeu n’est pas pour nous de détailler l’ensemble des thématiques développées mais de reprendre les traits saillants et significatifs de son propos à savoir la richesse des mythes, la scène que propose le couple pour dire le désir des hommes et la dialectique des fantasmes de virginité et du démon de midi.
Avec ce livre[1], les amoureux de la littérature tiennent un pur chef-d’œuvre, quant aux psys (dont il est fait allusion dans la préface) ils y trouvent de quoi exercer leur sagacité, pour peu qu’ils aient quelques envies de sortir des sentiers battus.
Le narrateur, Espen, (sa coïncidence avec l’auteur reste très ambiguë, mais c’est la règle de tout récit) a tué un homme, il y a longtemps. De ce meurtre, commis dans une autre contrée que la sienne, il semble n’avoir jamais été vraiment inquiété, aussi allons-nous suivre avec lui une autre inquiétude, la sienne, tirée de ses propres fonds, dont le livre est la narration, en avertissant d’emblée que cette inquiétude n’est pas culpabilité, en tout cas pas simple culpabilité. Les circonstances de l’assassinat, connues bien-sûr par le récit qu’en tente le narrateur, ne seront jamais très claires : la jalousie, la rivalité à l’égard d’une femme, l’amitié déçue peut-être, tout cela reste flou, car ce n’est pas ce qui importe à Espen. Ce qui lui importe et qu’il ne cesse de répéter, c’est que cet assassinat était préparé de longue date et qu’il était inéluctable eu égard aux circonstances de la vie de son auteur.
Il est rare que tant d’émotion se dégage d’un texte psychanalytique. Suivre Pauline[1] est d’abord un texte courageux : choisir de publier un cas et de longuement le détailler ne se fait quasiment plus, tant il faut maintenant illustrer ses propos par des « vignettes cliniques », reflet le plus souvent de sa paresse conceptuelle et surtout d’un engagement minimaliste. Il est courageux aussi, d’annoncer d’emblée ce qui pourrait être pris (surtout pour les détracteurs de la psychanalyse) pour un échec, comme s’il fallait d’ailleurs un « happy end » forcé à l’instar des contes de fées, chez tous nos patients, alors qu’il ne s’agit que d’une tranche de vie dont on peut espérer qu’elle les protège de l’asservissement à quelques liens.
Car la première qualité de Suivre Pauline est de mettre en mots une cure où il s’agit de courir derrière sa patiente, et d’avoir littéralement du mal à la suivre. La force du récit c’est cette course haletante et interrogative, centrée sur les doutes, les hésitations et les inquiétudes de l’analyste. Comme si être analyste, ça allait de soi et qu’il fallait se suffire de laisser causer…
Le terme « cabinet » vient du mot cabine (1491), et désigne en premier lieu, une chambre retirée dépendant d’une plus grande.
Quelque chose comme une petite pièce à part, abri, refuge, lieu d’étude.
D’abord cela. Après quoi l’Histoire ira bon train, avec les cabinets de travail et d’études, le cabinet de lecture, le cabinet noir espion pour le gouvernement, mais au départ une pièce sans fenêtre et sans lumière, où l’on enfermait les enfants pour les punir, les cabinets d’aisances ou de toilettes, le cabinet médical, le cabinet de curiosités prélevant des objets incongrus et inclassables, produit par l’improbable fabrique de la nature et de la culture.
« La douceur allège la peau, disparaît dans la texture même des choses, de la lumière, du toucher, de l’eau. Elle règne en nous par de minuscules brisures de temps, donne de l’espace, enlève leur poids aux ombres. »[2]
C’est souvent la surprise qui laisse les marques les plus profondes. Que ce soit la marque au fer rouge du traumatisme. Ou la marque inattendue d’une lecture, tout à coup, qui vient introduire un nouveau monde, une voix nouvelle dans le familier intérieur. Un de ces livres que l’on a choisi distraitement, dans les errances un peu vagues en librairie au seuil de l’été – tout ce que l’on pas vu passer cette année, en quête si possible de quelque chose de léger, qui vienne trouer de fraîcheur le plomb caniculaire, trouer le plein de vide propre à cette époque pourtant serrée de près par la guerre et la catastrophe. Et si possible alors, relever un peu l’insistance du motif des violences, à nombreux endroits de ma pratique, sans s’endormir sur le pire, sinon à prendre les armes, du moins à produire, « (se) donner des armes », et ce que cela signifie et lesquelles, n’est-ce pas une question qui nous engage comme citoyens, mais aussi comme analystes, et comment ?
