Freud avait mis en lumière une question déterminante dans son cheminement qu’est-ce qu’un père ? De Neuter offre un parcours non dénoué d’intérêt et d’une foisonnante culture. Freud avait tenté de répondre à une question qui jalonne son cheminement avec une forte insistance : qu’est-ce qu’un père ? De Neuter propose des variations autour d’une autre question qui s’exprime peut-être à son insu, dans les multiples plis de son propos faisant fi de toute réflexion autour du genre, et même de toute forme de bisexualité psychique. Qu’est-ce qu’un homme ?
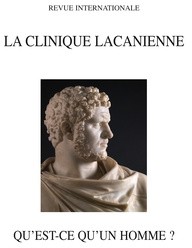
Le numéro 29 de la revue « La clinique lacanienne » nous permet ainsi de prolonger la réflexion vers d’autres sentiers.
« C’était un monstre mi taureau, mi-homme, rejeton de la femme de Minos, Pasiphaé, et d’un taureau d’une beauté merveilleuse. Poséidon avait un jour donné ce taureau à Minos afin que celui- ci le lui offrît en holocauste, mais Minois ne put se décider à la sacrifier et le garda pour lui. En guise de châtiment, Poséidon rendit Pasiphaé amoureuse de la bête. » (Hamilton, 1978, p. 182)
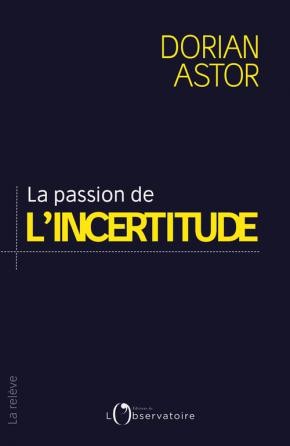
Autre texte, perspectives. « La passion de l’incertitude » (2020) de Dorian Astor nous offre également à penser hors de tout manichéisme ambiant. Ainsi il nous permet d’entendre une autre façon de penser les temporalités et nous plonge dans l’œuvre de Nietzsche en nous apportant une dialectique de l’incertitude et de la certitude au temps du foisonnement des experts en tout genre. Si De Neuter s’est intéressé à interroger le mythe de l’enlèvement d’Europe, d’autres situent le mythe au cœur de la question des origines dans une nécessité de reprendre le <il (d’Ariane ?) de sa propre histoire en situant toute interprétation comme une généalogie. « Si nous avons une telle obsession des origines, quitte à nous repaître d’élucubrations, c’est que, faute de jamais sortir du labyrinthe, nous préférons fantasmer la rencontre du Minotaure. L’origine est un monstre avide de notre avidité de signes. » (Astor, 2020, p. 43). Grand lecteur et traducteur de Freud, Astor nous plonge dans l’œuvre de Nietzsche pour nous apporter une dialectique de l’incertitude et de la certitude sous la forme d’un traité contemporain des passions et articule la mémoire du passé, la perception du présent et la visée de l’avenir (Ibid., p.41). Ainsi, il construit une articulation entre l’incertitude de l’avenir et les échecs des processus de certification du passé. Le mythe du Minotaure lui semble plus pertinent pour rendre compte de l’angoisse face à la l’incertitude de l’avenir et la figure du Père Minotaure est une variation de la thématique de la question des origines à rebours du complexe d’Œdipe où le Père mort assure une forme de protection structurante. « Cette orientation n’a pas la vocation de construire un nouvel universel au détriment de l’Œdipe, mais elle rend compte de ce qui peut se jouer dans les situations traumatiques (guerre, viol, inceste, etc.). Elles produisent d’importantes carences affectives et de lourdes fragmentations dans la subjectivation. Il met en lumière des figures de pères Minotaure (Ibid., p.44-45) qui viennent à détruire toute forme d’individuation de leurs enfants et empêchent les tentatives de certifications dans la volonté de mettre en place une certitude centrée sur leur toute-puissance monstrueuse. » (Muths, 2022).
La dialectique de l’incertitude du passé et l’incertitude de l’avenir nous invite à penser les modalités actuelles de l’expérience du temps. Comment ne pas penser la stase mélancolique développée par Maldiney ? « La stase mélancolique déconstruit, […], la chronogénèse, c’est-à-dire la genèse subjective de la temporalité. Le mélancolique est incapable de créer du nouveau, et de survivre à la crise de l’événement. Le modèle de la mélancolie donne ainsi à penser la crise contemporaine de la temporalité. Notre culture est en difficulté pour porter le temps. Dans le mouvement de l’ex-sistence et des événements de la vie, le narcissisme individuel s’expose sans cesse à la mort et à la renaissance. La perte de l’homogénéité et de la contenance culturelle commune, entraîne une surchauffe du travail de chronogénèse que chacun compose face à l’histoire. Quand le tissu commun de sens ne contient plus l’élaboration de la chronogénèse individuelle, l’événement devient trauma. » (Arènes, 2017, p.294).
Bibliographie
Arènes, J. (2017). Filiation et transhumanisme. Adolescence, 352, 288-302. Astor, D. (2014). Nietzsche : La détresse du présent. Paris : Gallimard.
Astor, D. (2020). La passion de l’incertitude. Paris : L’Observatoire.
Caillois R. (1991). Le démon de midi. Paris : Fata Morgana. Gazalé, O. (2017). Le mythe de la virilité. Paris : Robert Laffont
Freud S. (1918) « Le tabou de la virginité ». Paris : PUF. La vie sexuelle, 1969, p. 66-80. Goguel d’Allandons T. (2007), dans Marzana M., Dictionnaire du corps, Paris : PUF Hamilton E. (1978). La mythologie, ses dieux, ses héros, ses légendes. Paris : Marabout. Maldiney, H. (2007). Penser l’homme et la folie. Grenoble : J. Million.
Muths S. (2022). « Astor D. Aq propos du livre « La passion de l’incertitude ». In Analysis, Vol.6, n°1,
p. 109-113.